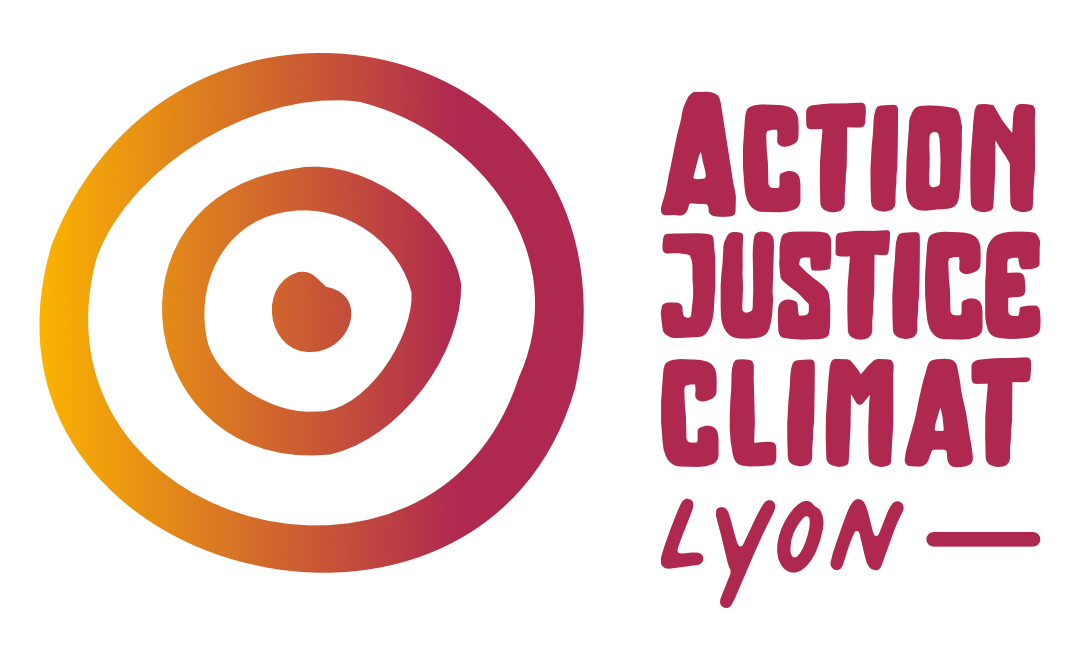La table ronde a eu lieu le 21 janvier 2024 à l’AlternatiBar, avec deux intervenantes :
- Marie Allenou, journaliste à Rue89Lyon
- Lola Keraron, journaliste pour la revue Silence
Rue89Lyon est un média lyonnais, 100% web, organisé en coopérative et détenu entièrement par ses trois journalistes. Le journal assume une ligne non partisane mais engagée, notamment contre l’extrême droite, et se concentre sur l’investigation et les enquêtes au long cours.
Silence est une revue papier, gérée par une association — c’est la plus ancienne revue écolo de France ! Les articles sont écrits par les salarié·es et des bénévoles, notamment pour présenter et défendre les alternatives collectives.
Ce texte présente un résumé des échanges qui ont eu lieu.
Média indépendant : késaco ?
Définir ce qu’est un média indépendant n’est pas si simple.
- Rue89Lyon appartient au Syndicat de la Presse Indépendante d’Information en Ligne (SPIIL). Pour celui-ci, un média est indépendant s’il est possédé par sa rédaction (comme Rue89Lyon) ou par un groupe ou entreprise dont l’information est l’unique activité.
- La revue Silence est fière de ne dépendre ni de subventions de l’État, ni d’actionnaires, ni de publicitaires : c’est la garantie de sa liberté de ton – comme chez Mediapart qui clame fièrement « Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter ! »
La question financière tient une place importante dans cette question. L’expérience montre que dépendre de subventions, même non conditionnées, est toujours risqué ; d’autant plus dans une région dirigée jusqu’à récemment par un certain Laurent Wauquiez (sur lequel Rue89Lyon a d’ailleurs une rubrique dédiée).
Le paysage médiatique
On parle jusqu’ici de presse, en ligne et sur papier. Mais Marie Allenou rappelle que le média le plus suivi aujourd’hui, c’est toujours la télévision : là-bas, pas d’indés, même s’il existe des tentatives comme Le Média.
C’est basta! qui nous rappelle que ce sont quelques oligarques qui détiennent l’immense majorité du paysage médiatique en France. Et même ça n’est que la partie la plus visible de l’iceberg. En effet, des grandes fortunes contrôlent également le reste de la chaîne de production de l’information : maison d’édition, points de diffusion, rien ou presque ne peut se faire en leur échappant totalement.
Pourquoi investir dans les médias lorsqu’on est déjà un des hommes les plus riches du pays (ou du monde pour Bernard Arnault) ? Lola Keraron donne deux raisons principales, avec le cas de Vincent Bolloré :
- défendre des intérêts industriels, en France et ailleurs : le groupe Bolloré est très implanté dans plusieurs pays d’Afrique, et ses médias y sont aussi (Canal+)
- mettre en avant un projet politique en saturant l’espace médiatique pour influencer l’opinion
Marie Allenou rappelle qu’au moment des élections législatives de 2024, c’est Vincent Bolloré qui a personnellement œuvré pour permettre le rapprochement entre Marine Le Pen et Éric Ciotti, actant la bascule d’une partie de la droite traditionnelle à l’extrême droite.
Quand Vincent Bolloré rachète un média, il ne fait pas les choses à moitié, comme on a pu le voir successivement chez Canal+, Europe 1, ou plus récemment le JDD : c’est lui qui décide de la ligne éditoriale, et qui s’y oppose finit immanquablement par partir. Partir, mais pas n’importe comment ! C’est grâce au courage du journaliste Jean-Baptiste Rivoire, ancien de Spécial investigation, qu’on sait que le milliardaire force les personnes qui partent à signer une clause de confidentialité qui les empêche de raconter ce qui se passe dans les médias bollorisés.
À la question venue du public des « riches de gauche » qui pourraient investir dans les médias, à l’image du milliardaire Matthieu Pigasse, les deux intervenantes répondent d’une seule voix : ça ne peut pas être une solution, l’enjeu n’est pas d’avoir « nos riches à nous » mais bien de libérer définitivement l’information du joug des milliardaires.
Décalage à droite généralisé
La « fenêtre d’Overton » : cette allégorie désigne l’ensemble des idées et discours considérés comme acceptables. C’est précisément pour décaler cette fenêtre dans le sens qui les arrange que des milliardaires prennent le contrôle de médias !
Le journalisme, rappelle Marie Allenou, ne consiste pas à donner la parole à tout le monde et exposer indifféremment toutes les idées : il s’agit au contraire de partir des faits, pour ensuite questionner ses interlocuteurs sur ces faits. C’est là où le principe de l’information « en continu » pose problème. Quand il n’y a plus assez de faits nouveaux pour alimenter la machine, les médias se rabattent sur ce qu’ils ont de plus simple à produire, la et c’est ainsi que des chaînes de télévision et de radio sont saturées d’émission de « débat » sur guère plus que du vent — ce que raconte bien un épisode de l’émission Rhinocéros de Blast.
Le problème ne se réduit pas aux médias bollorisés, ou autre-milliardairisés : en décalant la fenêtre d’Overton, en normalisant certains discours et en invisibilisant d’autres, c’est tout le paysage médiatique qui est influencé par contagion. Marie Allenou identifie une faille dans la formation même des journalistes. On y apprend la « neutralité », à croire que les journalistes sont capables de n’avoir aucun biais — et in fine ne font bien souvent que servir l’ordre établi. Elle lui préfère « l’honnêteté » : un·e journaliste est sujet·te comme n’importe qui à l’influences de ses idées, son milieu, son origine sociale, etc, et peut choisir de les accepter et de faire son travail le mieux possible en en tenant compte. C’est en raison de cette neutralité faussée que bien souvent, les médias ne sont plus en capacité de nommer correctement l’extrême droite, et n’arrivent donc parfois même plus à la voir.
La place des réseaux sociaux et des GAFAM
Comme plusieurs autres médias, Rue89Lyon a désormais quitté X (ex Twitter), et ne cache pas son inconfort à être encore sur les plateformes du groupe Meta (NB : pareil pour Action Justice Climat Lyon). Mais même sans les idées d’extrême droite, les réseaux sociaux commerciaux représentent de moins en moins une opportunité pour les médias indépendants : s’il y a quelques années ils représentaient encore une source de trafic conséquente, les liens externes (vers les articles, donc) sont de plus en plus bloqués ou invisibilisés. De la même façon, Google contrôle en partie la façon dont le public accède à l’information, et n’est pas du tout favorable aux médias indépendants.
Pour Silence, la question est un peu plus simple : la revue a fait le choix du papier ! Dans une posture plutôt technocritique, certains réseaux sociaux ont été testés par le passé mais rapidement abandonnés. Globalement, les algorithmes de recommendation ne semblaient pas mettre en avant les contenus traités. Reste la question de comment toucher le public : les habitudes changent, et les longues enquêtes sur papier font de moins en moins partie des habitudes — la revue est donc dans une situation difficile.
Comment s’organisent les médias indépendants ?
Rue89Lyon mutualise une partie de ses ressources, notamment l’infrastructure numérique, avec deux autres éditions locales : Rue89Bordeaux et Rue89Strasbourg. Un partenariat est également en place avec Mediapart : certains articles sont publiés simultanément dans les deux médias. C’est à la fois un gage de confiance et un soutien financier. Comme évoqué en début d’article, Rue89Lyon est également membre du SPILL avec de nombreux autres médias.
Silence appartient au Syndicat de la Presse Pas Pareille (SPPP). Ensemble, ses membres réfléchissent à des offres d’abonnement groupé et à des enquêtes communes (par exemple sur l’empire Bolloré !)
Quel soutien militant aux indés ?
L’indépendance des médias vaut aussi vis-à-vis des organisations militantes ! Pour autant, nous avons des objectifs en commun.
Nous pouvons au sein de nos organisations et pour notre public mettre en place de l’éducation aux médias : une certaine défiance envers la presse s’est progressivement installée (non sans raisons), et il s’agit de redonner de la confiance, mais pas aveuglément.
Nous pouvons également nous emparer de l’information, des enquêtes produites. Si les médias existent, ça n’est pas juste pour le plaisir de raconter des choses, mais bien pour influer sur la marche du monde : les articles et les reportages sont là pour être discutés, débattus, pour infuser dans nos campagnes et nos mobilisations.
Il y a également des actions militantes qui ciblent directement les médias. Lola Keraron cite notamment le travail du collectif Sleeping Giants : le groupe tape directement au portefeuille des médias d’extrême droite en affichant publiquement les marques qui les financent via la publicité, pour les pousser à s’en retirer, et couper les vivres à la haine.
Le mot de la fin
Ce compte-rendu est terminé. Il est forcément imparfait et incomplet, mais tente de rendre compte correctement de ce qui s’est dit lors de cette table ronde. S’il vous a plu, vous pouvez bien sûr le partager, mais aussi : nous faire un don, vous abonner à Silence, Rue89Lyon ou un autre média indépendant, rejoindre un collectif de lutte près de chez vous, ou tout ça à la fois !


.avif)